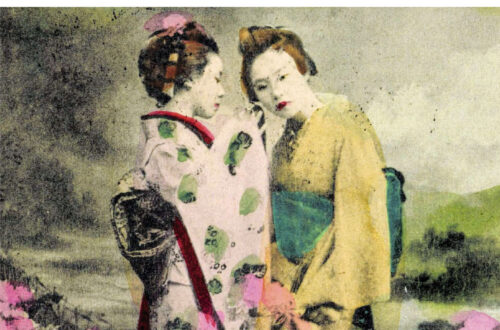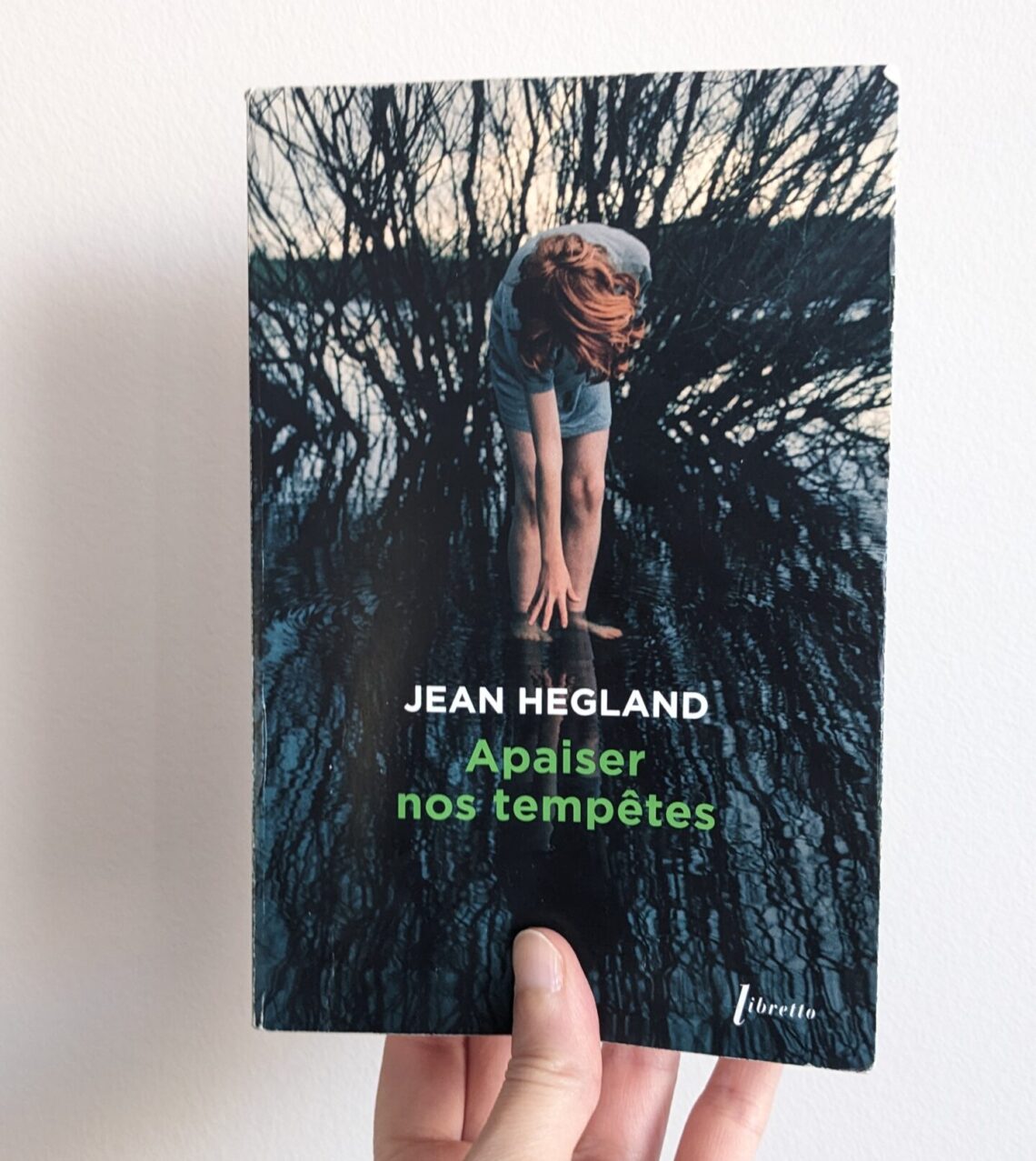
Apaiser nos tempêtes de Jean Hegland
La sortie du nouveau roman de Jean Hegland m’a donné envie de sortir son tout premier roman, Apaiser nos tempêtes, qui patientait dans mes étagères [pourquoi faire comme tout le monde quand on peut avoir trois trains de retard ?].
Résumé
Anna et Cerise sont toutes deux adolescentes lorsqu’elles découvrent qu’elles sont enceintes. L’une est en première année d’école d’art, l’autre encore au lycée. Chacune va faire un choix différent face à l’annonce de cette grossesse.
On les retrouve une grosse dizaine d’années plus tard : leurs vies sont alors diamétralement opposées. On les suit dans leur quotidien jusqu’au jour où leurs chemins vont finir par se croiser.
Ce que j’en ai pensé ?!
Apaiser nos tempêtes est construit en plusieurs grandes parties, marquant chacune un moment fort du récit et composées de chapitres alternant les points de vue de Cerise et Anna. Le tout, raconté par un narrateur omniscient, à la 3e personne du singulier. Au départ, cette alternance de point de vue a pu me gêner car la temporalité entre les deux récits n’était pas tout à fait identique. Puis, à partir du moment où les deux jeunes femmes vivent dans la même ville, les deux rythmes se sont calés l’un sur l’autre et cela a rassuré mon côté psychorigide.
J’ai quelque peu lutté au début de cette lecture mais je ne sais pas trop si je dois l’imputer au fait que je n’avais pas vraiment le temps de le lire et que je ne l’approchais donc que par petites tranches, à intervalle très irrégulier. Ou si, simplement, je n’adhérais pas suffisamment à ce que je lisais. Vous allez comprendre pourquoi…
Cerise et Anna viennent de milieux assez différents : sans être riche, Anna appartient à une classe moyenne assez éduquée qui a eu la possibilité de poursuivre des études supérieures tandis que Cerise n’a pas terminé le lycée. Cette différence de classe sociale aura un impact très fort sur les alternatives qui seront les leurs quand elles devront faire des choix importants pour leur avenir.
La première chose qui réunit Anna et Cerise, c’est le fait d’être tombées enceintes, chacune à la sortie de l’adolescence. Anna fait le choix d’avorter pour continuer ses études tandis que Cerise, contre l’avis de sa mère, décide de garder l’enfant. Enfin… On peut se poser la question du choix éclairé dans son cas puisqu’au moment où elle cherche de l’aide et de l’information au sujet de sa grossesse, les premières personnes qu’elle rencontre sont les membres d’un groupe anti-ivg qui la persuadent de garder l’enfant. Cela démontre à quel point ces groupes sont organisés et ciblent les femmes peu éduquées, en difficulté. Et aussi, le fait que tout ce qui les intéresse, c’est de s’assurer de la naissance de l’enfant, qu’importe la situation potentiellement critique dans laquelle il devra ensuite vivre.
D’ailleurs, l’autrice met en évidence les manières immondes de ces groupements anti-ivg [non, ils ne sont pas « pro vie »], notamment au moment où Anna tente de rejoindre le centre de planning familial. Ce qui m’a surtout posé problème, dans la manière dont l’autrice présente les choses, c’est que nous ne savons pas exactement à quelle époque ces éléments se déroulent [sans doute dans les années 70 – début 80]. Or, le livre étant sorti assez récemment en français, cela pourrait induire en erreur les lecteurs et lectrices peu renseigné·es sur le sujet et les effrayer sur les conditions dans lesquelles se déroulent un avortement [une petite note de la traductrice n’aurait pas fait de mal].
Globalement, je me suis davantage identifiée à Anna plutôt qu’à Cerise : nous sommes plus proches sur le plan socio-économique et culturel. Dès lors, j’ai été désagréablement surprise par son évolution de point de vue à propos de la maternité, dans le dernier tiers du roman. Je comprends que l’autrice veuille montrer qu’une femme qui avorte à un moment T n’est pas nécessairement anti-maternité et que le fait d’avoir un enfant au bon moment doit être un choix conscient et protégé. Mais fallait-il vraiment verser dans le cliché de la « révélation maternelle » plus forte que notre raison par la suite ?! Je ne veux pas divulgâcher le roman mais celles et ceux qui l’ont lu comprendront de quoi je veux parler : cela m’a déçue.
J’ai également trouvé que le sort s’acharnait un peu trop fort sur Cerise et que l’on voyait arriver les drames de manière beaucoup trop évidente. Mais j’ai aimé que l’autrice prenne le temps de décrire ce que signifie la précarité et la pauvreté parfois extrême lorsque l’on est une femme. Ce ne sont pas des sujets qui sont si souvent que cela décrits dans la littérature et encore moins à l’époque où elle a écrit ce roman. Et bien que celui-ci ait plus de 20 ans, je le trouve encore criant d’actualité et de modernité.
L’autrice développe également une réflexion autour de l’art et de son rôle ou non dans la société [ça ferait du bien à GLouB de le lire, tiens !]. Le fait d’y mêler les pensées de plusieurs personnes ayant toutes un rapport très différent à l’art est très intéressant : cela nous invite à nous questionner à notre tour.
La construction du récit et la langue de l’autrice rendent la lecture très fluide et immersive [j’ai failli rater mon arrêt de bus plusieurs fois]. Le découpage nous donne envie d’avancer à la partie suivante pour connaître la suite et parfois, on est quelque peu frustré·e de devoir changer de point de vue. Bref, c’est un page-turner !
La nature a aussi une grande place dans ce récit [j’ai l’impression que c’est une des marques de fabrique de Jean Hegland] et certaines descriptions de paysages sont de vrais moments de poésie.
Bref, après un démarrage compliqué et les quelques bémols que j’ai énoncés, j’ai adoré ce roman de Jean Hegland et la grande sensibilité qui s’en dégage. Je ne peux donc que vous inviter à découvrir, à votre tour, Apaiser nos tempêtes.
Infos pratiques
- Titre : Apaiser nos tempêtes
- Autrice : Jean Hegland
- Traductrice : Nathalie Bru
- Année de 1ère publication : 2004
- Édition : Libretto, 2024
- Nombre de pages : 464 pages